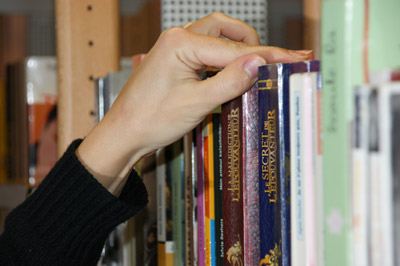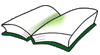Exemplaires(1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21134 | CDMA | Périodique | CDMA | Documentaire | Disponible |
Dépouillements

 Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panierNon ! Le nombre de suicides en France ne diminue pas / J.-L. Ducher in L'encéphale, Vol 38. Fas 5-Octobr (2012)
inL'encéphale > Vol 38. Fas 5-Octobr (2012) . - 371-372 p.
Titre : Non ! Le nombre de suicides en France ne diminue pas Type de document : texte imprimé Auteurs : J.-L. Ducher ; P.-M. Llorca Année de publication : 2012 Article en page(s) : 371-372 p. Note générale : Octobre 2012. Reçu le 25 Octobre 2012 Langues : Français (fre) Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76292 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21134 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible L'état de stress post-traumatique comme conséquence de l'interaction entre une susceptibilité génétique individuelle, un évènement traumatogène et un contexte social / Yann Auxéméry in L'encéphale, Vol 38. Fas 5-Octobr (2012)
inL'encéphale > Vol 38. Fas 5-Octobr (2012) . - 373-380 p.
Titre : L'état de stress post-traumatique comme conséquence de l'interaction entre une susceptibilité génétique individuelle, un évènement traumatogène et un contexte social Type de document : texte imprimé Auteurs : Yann Auxéméry Année de publication : 2012 Article en page(s) : 373-380 p. Note générale : Octobre 2012. Reçu le 25 Octobre 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] prévention
[Thesaurus n°1] psychopathologieMots-clés : État de stress post-traumatique Traumatisme psychique État de stress aigu Débriefing Comorbidités Interaction gènes environnement Anthropologie Traitement Résumé : Un état de stress post-traumatique (ESPT) ne s'installe jamais par hasard : l'intrication de facteurs de risque intrinsèques (individuels) et extrinsèques (évènement traumatique) témoigne d'un support génétique interactif au trouble. Toute situation dramatique peut être le lieu d'un trauma, non nécessairement, mais en lien avec la manière dont l'individu a investi l'évènement. Parmi les sujets confrontés à la même situation stressante, seuls quelques uns souffriront d'un ESPT. Pour ces derniers, la thématique des répétitions est très différente d'un sujet à un autre, venant témoigner de la singularité de l'évènement vécu pour chacun d'entre eux. Comme témoignage d'une interaction entre l'homme et son environnement, le stress est une réaction biologique aspécifique de l'organisme, mais réaction déclenchée par un ressenti subjectif. L'ESPT en tant que diagnostic causalement attribué s'intègre parfaitement dans le modèle interactif gène * environnement.Revue de la littératureLes sujets présentant le génotype S/S codant pour le transporteur de la sérotonine déclenchent un ESPT pour un niveau d'exposition traumatique moindre que leurs homologues L/L. Mais l'interaction entre le génome et son environnement est plus complexe qu'une simple implication : une association de facteurs environnementaux intervient. Considérant la voie dopaminergique, l'allèle A1 codant pour le récepteur dopaminergique de type 2 est associé à une comorbidité sévère de l'ESPT avec présence de troubles somatiques, d'anxiété, d'altération sociale et de dépression. S'intéressant à la neuromodulation noradrénergique, une interaction entre le polymorphisme du gène GABRA2 et la survenue d'un ESPT est décrite tandis qu'une interaction entre le nombre d'évènements traumatiques et le polymorphisme Val(158)Met du gène codant pour la catécholamine-o-méthyltransférase a également été retrouvée. Au niveau neuroendocrinien, le gène codant pour la pr Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76293 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21134 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Évolution des styles d'attachement romantique et interpersonnel au cours de l'hospitalisation chez des femmes adultes déprimées / M. Reynaud in L'encéphale, Vol 38. Fas 5-Octobr (2012)
inL'encéphale > Vol 38. Fas 5-Octobr (2012) . - 381-389 p.
Titre : Évolution des styles d'attachement romantique et interpersonnel au cours de l'hospitalisation chez des femmes adultes déprimées Type de document : texte imprimé Auteurs : M. Reynaud ; K. Chahraoui ; A. Vinay Année de publication : 2012 Article en page(s) : 381-389 p. Note générale : Octobre 2012. Reçu le 25 Octobre 2012 Langues : Français (fre) Mots-clés : Dépression Style d'attachement Attachement interpersonnel Attachement romantique Vulnérabilité Résumé : Cette étude a pour objectif d'investiguer, chez des femmes adultes déprimées hospitalisées, les liens entre attachement et dépression au regard de l'évolution de leurs styles d'attachement romantique et interpersonnel entre le début et la fin de leur hospitalisation. Cinquante femmes déprimées ont participé à deux investigations psychologiques au début (T1) et à la fin de l'hospitalisation (T2) comportant à chaque fois un entretien clinique au cours duquel étaient évalués la dépression et les styles d'attachement romantique (ECR, 1998) et interpersonnel (RQ, 1991). Les résultats montrent que la dépression est corrélée positivement à la dimension « évitante » du style d'attachement romantique et négativement à la dimension « secure » du style d'attachement interpersonnel. Entre le début et la fin de l'hospitalisation, seules les dimensions « secure » et « craintif » des styles d'attachement interpersonnel sont modifiées alors que les styles d'attachement romantique restent stables. L'augmentation de la sécurité d'attachement est aussi corrélée à la baisse de la symptomatologie dépressive. Ces résultats permettent de discuter de la stabilité et du changement des styles d'attachement romantique et interpersonnel en relation avec l'évolution de la symptomatologie dépressive. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76294 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21134 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Régulation émotionnelle chez des consommateurs de psychostimulants en milieu festif techno / Caroline Lillaz in L'encéphale, Vol 38. Fas 5-Octobr (2012)
inL'encéphale > Vol 38. Fas 5-Octobr (2012) . - 390-396 p.
Titre : Régulation émotionnelle chez des consommateurs de psychostimulants en milieu festif techno Type de document : texte imprimé Auteurs : Caroline Lillaz ; I. Varescon Année de publication : 2012 Article en page(s) : 390-396 p. Note générale : Octobre 2012. Reçu le 25 Octobre 2012 Langues : Français (fre) Mots-clés : Émotions Sensations Consommation Dépression Conscience émotionnelle Fêtes techno Résumé : Cette recherche a pour objectif principal d'évaluer la recherche de sensations, l'alexithymie, la conscience émotionnelle et la dépression chez des consommateurs de psychostimulants en milieu festif techno. Nous suivons les hypothèses que les consommateurs de psychostimulants présenteraient un niveau de recherche de sensations élevé et des déficits dans la régulation des émotions (scores d'alexithymie et de symptomatologie dépressive élevés et de conscience émotionnelle bas). Trente-sept sujets présentant un abus de psychostimulants ont été comparés à groupe de 37 sujets non consommateurs de substances psychoactives. La méthodologie retenue comporte un questionnaire élaboré pour la recherche visant à recueillir les données sociodémographiques et à évaluer la consommation de substances psychoactives, le Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI), l'échelle de recherche de sensations de Zuckerman à 40 items (SSS-IV), l'échelle d'alexithymie (TAS-20), l'échelle des niveaux de conscience émotionnelle (LEAS) et l'inventaire abrégé de dépression (BDI-13). Les consommateurs de psychostimulants ont été recrutés en milieu écologique lors de « rave-party ». Les résultats montrent des scores significativement plus élevés de recherche de sensations (score total, sous-dimensions « désinhibition », « recherche d'expériences »), d'alexithymie (score total et dimension « difficultés à décrire ses sentiments ») et de symptomatologie dépressive pour les consommateurs abuseurs comparativement aux sujets du groupe témoin. Les consommateurs présentent également des scores significativement plus bas de conscience émotionnelle (score « autre personne »). Les résultats apportent des éléments nouveaux concernant le profil des consommateurs en milieu festif techno. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76295 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21134 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Les prodromes des rechutes schizophréniques : étude descriptive et comparative / S. Bouhlel in L'encéphale, Vol 38. Fas 5-Octobr (2012)
inL'encéphale > Vol 38. Fas 5-Octobr (2012) . - 397-403 p.
Titre : Les prodromes des rechutes schizophréniques : étude descriptive et comparative Type de document : texte imprimé Auteurs : S. Bouhlel ; Y. Jones ; E. Khelifa Année de publication : 2012 Article en page(s) : 397-403 p. Note générale : Octobre 2012. Reçu le 25 Octobre 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] prévision
[Thesaurus n°1] Sciences de la nature:génétique:évolution
[Thesaurus n°1] Troubles psychotiques:SchizophrénieMots-clés : Récidive Résumé : Introduction :La détection des prodromes des rechutes schizophréniques a un intérêt préventif, toutefois les études consacrées à ce sujet restent rares. But du travail : Décrire la fréquence et les délais d'apparition des symptômes prodromaux des rechutes schizophréniques qui sont comparativement plus fréquents que les symptômes présentés par des patients en rémission. Méthodes : L'étude a porté sur 30 sujets atteints de schizophrénie en rechute et 30 en rémission, chez qui les prodromes ont été recherchés rétrospectivement à partir d'une liste composée de 93 symptômes. Résultats : La durée moyenne de la phase prodromale était de 160,5 jours. Les prodromes significativement plus fréquents dans le groupe « rechute » que dans le groupe « rémission » étaient les idées surinvesties/délire (93,3 % des sujets en rechute), les troubles du sommeil (80 %), les symptômes de désorganisation (80 %) et les symptômes d'excitation/labilité thymique (73,3 %). Les symptômes non spécifiques précédaient les symptômes spécifiques (149,4 jours versus 94,8 jours). Les prodromes les plus précoces étaient le syndrome d'influence (113,4 jours avant la rechute), l'hétéroagressivité non physique (108,1 jours) et les idées suicidaires (94,8 jours).Conclusion : Un dépistage plus précoce des prodromes par le médecin, la famille ou le patient lui-même est nécessaire. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76296 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21134 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Les troubles dépressifs chez les patients diabétiques du centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech au Maroc / F. Manoudi in L'encéphale, Vol 38. Fas 5-Octobr (2012)
inL'encéphale > Vol 38. Fas 5-Octobr (2012) . - 404-410 p.
Titre : Les troubles dépressifs chez les patients diabétiques du centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech au Maroc Type de document : texte imprimé Auteurs : F. Manoudi ; R. Chagh ; I. Benhima Année de publication : 2012 Article en page(s) : 404-410 p. Note générale : Octobre 2012. Reçu le 25 Octobre 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] diabète Mots-clés : Épisode dépressif majeur Dysthymie Double dépression Prévalence Résumé : Le diabète est une pathologie métabolique chronique fréquente qui touche 6,6 % des marocains. De nombreuses études épidémiologiques montrent que le diabète et les troubles dépressifs s'associent de manière non fortuite et se compliquent mutuellement.Nous avons mené une étude transversale afin d'évaluer la prévalence de l'épisode dépressif majeur (EDM), de la dysthymie et de la double dépression chez les patients diabétiques et de tracer leur profil sociodémographique et médical.Nous avons recruté 187 patients au niveau du service d'endocrinologie diabétologie et au niveau de la consultation diabétologie du centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech (Maroc). Le diagnostic des troubles dépressifs était posé par le Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) et leur sévérité évaluée par l'échelle Hamilton dépression (HAMD).Le recueil des données sociodémographiques et des caractéristiques du diabète était fait par un hétéro-questionnaire.L'âge moyen de nos patients était de 53 + 14 ans, 71,2 % étaient de sexe féminin. L'EDM actuel était retrouvé chez 77 diabétiques, soit 41,2 % des patients. La dysthymie était présente chez 52 diabétiques, soit 27,8 % des patients et la double dépression était diagnostiquée chez 21,9 % des diabétiques. À l'échelle HAMD, tous les patients déprimés avaient une dépression d'intensité légère. La prévalence actuelle de l'EDM et de la dysthymie était plus importante chez les patients vus en consultation que chez les patients hospitalisés au service d'endocrinologie avec respectivement 57,1 %, contre 42,9 % et 61,5 %, contre 38,5 %. La dysthymie était prédominante chez les diabétiques de la tranche d'âge 46 à 55 ans, les patients jamais scolarisés et chez les patients indemnes de toute pathologie chronique associée.En conclusion, la prévalence importante des troubles dépressifs retrouvée chez notre population de diabétiques justifie leur recherche systémat Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76297 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21134 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Limites et ambiguïtés juridiques du rôle des aidants familiaux / Cyril Hazif-Thomas in L'encéphale, Vol 38. Fas 5-Octobr (2012)
inL'encéphale > Vol 38. Fas 5-Octobr (2012) . - 411-417 p.
Titre : Limites et ambiguïtés juridiques du rôle des aidants familiaux Type de document : texte imprimé Auteurs : Cyril Hazif-Thomas ; P. Thomas ; M. Walter Année de publication : 2012 Article en page(s) : 411-417 p. Note générale : Octobre 2012. Reçu le 25 Octobre 2012 Langues : Français (fre) Mots-clés : Aidants familiaux Expertise profane Éthique Acte médical Règle de loyauté Aspects légaux Résumé : À une époque volontiers marquée par la valorisation du patient comme support d'une expertise profane, il est utile de faire le point sur les limites de l'implication des aidants informels qui prennent en charge les personnes dépendantes ou handicapées. Ceux-ci participent au parcours de soins du patient dans le but de protéger au mieux leur proche. Cela ne va pas sans influer sur l'évolution du soin, notamment psychique, et la forme que prend l'acte médical. Ce travail analyse le contexte juridique français, au miroir de l'expérience pratique des équipes gérontopsychiatriques. Un point juridique est présenté sur les contours de l'aide bénévole apportée par les familles et/ou des proches familiers. La conception ouverte à la reconnaissance des aidants familiaux, sans pour autant ignorer la position de quasi-tutelle qu'ils investissent le cas échéant, n'est pas sans poser de nombreux problèmes éthiques et de prise en charge. Les difficultés rencontrées par les aidants sont pour une part liées au manque de définitions juridiques tant de l'acte médical que des missions attendues de l'aidant familial. Ce manque reflète aussi les problèmes posés au législateur pour définir ce qui est de l'ordre de l'aide naturelle familiale et ce qui nécessiterait de faire appel à la solidarité collective. L'évolution des rôles des aidants dans notre société confrontée à la pandémie de maladies chroniques implique donc une évolution du droit positif dans le domaine de l'aide familiale. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76298 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21134 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Étude du tempérament et de la personnalité chez l'enfant souffrant d'un trouble déficit d'attention/hyperactivité (TDAH) / Martine Bouvard in L'encéphale, Vol 38. Fas 5-Octobr (2012)
inL'encéphale > Vol 38. Fas 5-Octobr (2012) . - 418-425 p.
Titre : Étude du tempérament et de la personnalité chez l'enfant souffrant d'un trouble déficit d'attention/hyperactivité (TDAH) Type de document : texte imprimé Auteurs : Martine Bouvard ; L. Sigel ; A. Laurent Année de publication : 2012 Article en page(s) : 418-425 p. Note générale : Octobre 2012. Reçu le 25 Octobre 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] personnalité Mots-clés : Trouble déficitaire de l'attention hyperactivité Tempérament Système d'inhibition et d'activation comportementale Résumé : Cette recherche a pour objectif, d'une part, de comparer l'opinion des parents et des enfants concernant la personnalité de l'enfant et d'autre part, de comparer la personnalité d'enfants diagnostiqués d'un trouble déficit d'attention/hyperactivité (TDAH) à des sujets témoins. Dans une première étude, nous avons comparé à un an d'intervalle l'opinion de 33 enfants TDAH sur leur personnalité ainsi que l'opinion de leurs parents. Les réponses des enfants comme celles des parents ont été comparées au temps 1 et au temps 2 (questionnaire émotionnalité, activité, sociabilité (EAS) et échelles du système d'inhibition comportementale [BIS] et du système d'activation comportementale [BAS]). Les parents présentent une bonne stabilité dans leur opinion concernant le tempérament de leur enfant. En revanche, les enfants présentent une opinion moins stable les concernant. Les corrélations entre les deux passations varient de 0,22 (échelle BAS de recherche d'amusement) à 0,51 (échelle BIS) pour les échelles BIS et BAS et de 0,32 (EAS émotionnalité) à 0,58 (EAS activité et timidité). Puis, nous avons comparé les réponses des enfants et de leurs parents sur le questionnaire EAS. Elles apparaissent beaucoup plus élevées que celles trouvées dans une population issue de la population générale. Dans la seconde étude, nous avons comparé la personnalité de l'enfant TDAH (n = 35) à celle de sujets issus de la population générale (n = 35) sur les échelles BIS et BAS, le questionnaire EAS et un questionnaire évaluant les cinq facteurs de personnalité (BFQ-C). En ce qui concerne le BIS, les sujets TDAH sont comparables aux sujets témoins. En revanche, ils obtiennent comme attendu, des notes plus élevées dans le BAS. Dans les traits de tempérament, les sujets TDAH se reconnaissent plus actifs et avoir une plus grande émotionnalité que les sujets témoins. Il n'y a pas de différence sur les deux autres traits de tempérament, sociab Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76299 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21134 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Relations entre intelligence émotionnelle, alexithymie et comportements délinquants de type interpersonnel dans un échantillon d'adolescents scolarisés / C. Berastegui in L'encéphale, Vol 38. Fas 5-Octobr (2012)
inL'encéphale > Vol 38. Fas 5-Octobr (2012) . - 426-432 p.
Titre : Relations entre intelligence émotionnelle, alexithymie et comportements délinquants de type interpersonnel dans un échantillon d'adolescents scolarisés Type de document : texte imprimé Auteurs : C. Berastegui ; N. Van Leeuwen ; H. Chabrol Année de publication : 2012 Article en page(s) : 426-432 p. Note générale : Octobre 2012. Reçu le 25 Octobre 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] adolescent Mots-clés : Alexithymie Intelligence émotionnelle Comportements délinquants de type interpersonnel Résumé : L'objectif de cette étude était d'explorer les relations entre l'intelligence émotionnelle, l'alexithymie et les comportements délinquants de type interpersonnel, au sein d'une population d'adolescents scolarisés. Un échantillon de 176 lycéens a été évalué par l'échelle d'alexithymie de Toronto à 20 items (TAS-20), la version française du « Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Adolescent Short Form » (TEIQue-ASF) et les items d'un questionnaire composite évaluant les comportements délinquants de type interpersonnel (QDAR ; ABS ; SRDB). Les résultats ont montré des corrélations significatives entre les comportements délinquants de type interpersonnel, l'alexithymie et l'intelligence émotionnelle. Une analyse de régression multiple a permis de mettre en évidence que seule l'alexithymie, et plus particulièrement la difficulté à identifier les sentiments (DIS), était en lien avec les comportements délinquants de type interpersonnel chez les garçons comme chez les filles. Ces résultats montrent l'importance de prendre en compte les facteurs émotionnels dans la prise en charge des adolescents ayant des comportements antisociaux. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76300 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21134 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Similitudes et différences entre le jeu pathologique et la dépendance aux substances : qu'en est-il ? / E. Bosc in L'encéphale, Vol 38. Fas 5-Octobr (2012)
inL'encéphale > Vol 38. Fas 5-Octobr (2012) . - 433-439 p.
Titre : Similitudes et différences entre le jeu pathologique et la dépendance aux substances : qu'en est-il ? Type de document : texte imprimé Auteurs : E. Bosc ; M. Fatseas ; M. Auriacombe Année de publication : 2012 Article en page(s) : 433-439 p. Note générale : Octobre 2012. Reçu le 25 Octobre 2012 Langues : Français (fre) Mots-clés : Jeu pathologique Troubles liés à une substance Addiction Résumé : Un débat est en cours sur l'intégration du jeu pathologique dans le spectre des addictions sur le modèle de la dépendance aux substances. Dans cette perspective, notre objectif était de faire le relevé systématique des similitudes et différences entre ces deux maladies, de les classer puis de les analyser, à partir de l'expertise de l'Inserm sur les jeux de hasard et d'argent. Les aspects communs relevés portaient sur les caractéristiques épidémiologiques, les critères diagnostiques du DSM-IV, l'association de ces troubles, leurs caractéristiques neurobiologiques, des cas de guérisons spontanées et les aspects communs des prises en charge. Les différences concernaient une prévalence du trouble de l'humeur plus élevée chez les joueurs pathologiques, les facteurs de risque intrinsèques au jeu, les erreurs cognitives du joueur pathologique (notamment le chasing), les spécificités des thérapies cognitivo-comportementales centrées sur ces erreurs et celles de la prise en charge sociale des joueurs pathologiques. Néanmoins, notre analyse critique de ces éléments pourtant rapportés comme spécifiques au jeu pathologique a mis en valeur des points communs avec la dépendance aux substances. Les phénomènes de craving et de perte de contrôle non discutés dans l'expertise pourraient aussi constituer des éléments clés en faveur du regroupement de ces troubles. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76302 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21134 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Homicide et épisode psychotique aigu cortico-induit : à propos d'un cas / Guillaume Airagnes in L'encéphale, Vol 38. Fas 5-Octobr (2012)
inL'encéphale > Vol 38. Fas 5-Octobr (2012) . - 440-444 p.
Titre : Homicide et épisode psychotique aigu cortico-induit : à propos d'un cas Type de document : texte imprimé Auteurs : Guillaume Airagnes ; C. Rouge-Maillart ; J.-B. Garré Année de publication : 2012 Article en page(s) : 440-444 p. Note générale : Octobre 2012. Reçu le 25 Octobre 2012 Langues : Français (fre) Mots-clés : Corticoïdes Corticothérapie Effets indésirables psychiatriques Psychose cortico-induite Traitement État confuso-onirique Résumé : Environ 5 % des patients traités par corticothérapie sont sujets à des réactions psychiatriques sévères. Malgré la pauvreté de la littérature, ces situations méritent d'être prises en charge activement et précocement compte tenu de leur potentielle gravité. Nous présentons le cas d'un patient de 77 ans, traité par méthylprednisolone depuis deux mois pour une leucémie lymphoïde chronique et qui a tué son épouse lors d'un état psychotique aigu. Celui-ci a pu être imputé aux effets iatrogènes des corticoïdes. Ce tableau s'était installé insidieusement, puis acutisé brutalement et c'est seulement au décours de son passage à l'acte que l'imputabilité des corticoïdes avait pu être établie. Au travers de cette illustration clinique, nous discutons l'importance d'un diagnostic précoce ainsi que les modalités de prise en charge des réactions psychiatriques sévères aux corticostéroïdes. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76303 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21134 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible