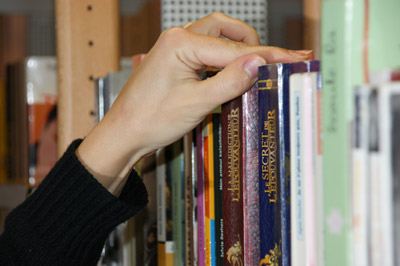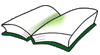Exemplaires(1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20553 | ARCHIVES | Périodique | CDMA | Documentaire | Disponible |
Dépouillements

 Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panierStress post-traumatique et altération des schémas cognitifs : cas de la victimation à l'école / Barbara Houbre in L'évolution psychiatrique, Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012)
inL'évolution psychiatrique > Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012) . - 1-14 p.
Titre : Stress post-traumatique et altération des schémas cognitifs : cas de la victimation à l'école Type de document : texte imprimé Auteurs : Barbara Houbre ; Virginie Dodeler ; Lydia Peter Année de publication : 2012 Article en page(s) : 1-14 p. Note générale : Reçu le 20 Mars 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] élève
[Thesaurus n°1] enquête
[Thesaurus n°1] violenceMots-clés : École Victimologie Syndrome post-traumatique Vulnérabilité Facteur de risque Questionnaire Résumé : Les agressions entre élèves en milieu scolaire constituent un problème grandissant. Le bullying peut être défini comme toutes formes de violences physiques ou mentales répétées, effectuées par un ou plusieurs individus sur une personne qui n'est pas capable de se défendre elle-même (Roland et Idsoe (2001) [1]). Cette étude a pour objectif d'observer le stress post-traumatique en lien avec ces agressions. Deux corollaires seront également abordés : l'altération de l'identité et l'effondrement des croyances fondamentales. Cinq cents vingt-quatre élèves âgés de 8 à 12ans (m =9,94) ont participé à l'étude. Les résultats montrent que près de 40 % des élèves victimes de bullying font état d'un stress post-traumatique. Par ailleurs, les élèves victimes d'agressions présentant un stress post-traumatique manifestent des croyances fondamentales et des conceptions de soi plus affaiblies que les autres. Toutefois, les analyses montrent que le facteur prépondérant à cette altération des schémas cognitifs n'est pas le stress post-traumatique mais bien la victimation elle-même. Ces différents résultats sont débattus à la lumière des travaux réalisés sur l'état de stress extrême non-spécifié. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73525 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20553 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible Souffrance « mentale » et douleur du corps. Étude de leur dimension économique à partir d'une séquence clinique / Julio Cesar Guillén in L'évolution psychiatrique, Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012)
inL'évolution psychiatrique > Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012) . - 15-28 p.
Titre : Souffrance « mentale » et douleur du corps. Étude de leur dimension économique à partir d'une séquence clinique Type de document : texte imprimé Auteurs : Julio Cesar Guillén ; Catherine Dupuis-Gauthier ; Fabrice Leroy Année de publication : 2012 Article en page(s) : 15-28 p. Note générale : Reçu le 20 Mars 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] clinique
[Thesaurus n°1] psychanalyseMots-clés : Douleur Corps Souffrance psychique Psychodynamie Sujet Cas clinique Résumé : Dans cet article nous étudions les différences et les liens entre les notions de « douleur » et de « souffrance » d'un point de vue économique à partir des modèles freudiens. La souffrance apparaît comme un phénomène complexe de localisation symbolique dans un espace subjectif qui permet d'élaborer l'excès et le désordre primordiaux face aux exigences provenant du corps et du monde extérieur. La douleur est présentée comme l'instant « catastrophique » face à l'envahissement de la stimulation propre à l'absence originaire de toute structure ou au dépassement des possibilités de réponse d'un système psychique déjà constitué. Dans ce dernier cas, la localisation, qui s'appuie sur l'organisme, s'effectue dans un espace fragmenté. Nous proposons de distinguer, d'un point de vue économique, d'un côté la tension ou charge de l'appareil psychique et de l'autre côté l'exigence de travail qui inclut la dimension temporelle. À partir de ces considérations théoriques, nous analysons la particularité d'un cas clinique où l'automutilation apparaît comme un comportement opérant sur le corps et destiné à interrompre la progression « sans fin » d'une souffrance « mentale ». L'instabilité de la construction psychique liée à l'absence de fonction inhibitrice de la souffrance montre l'échec de tout essai possible d'inscription subjective stable qui ne trouve de limite que par un recours direct à la douleur. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73526 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20553 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible Traumatisme sévère et psychose post-traumatique / Philippe Bessoles in L'évolution psychiatrique, Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012)
inL'évolution psychiatrique > Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012) . - 29-52 p.
Titre : Traumatisme sévère et psychose post-traumatique Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe Bessoles Année de publication : 2012 Article en page(s) : 29-52 p. Note générale : Reçu le 20 Mars 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] guerre
[Thesaurus n°1] psychopathologie
[Thesaurus n°1] violenceMots-clés : Psychose post-traumatique Originaire Traumatisme psychique Représentation Souffrance psychique Douleur Résumé : La question traumatique est au centre des nouveaux défis de la psychopathologie. Notre contribution de psychose post-traumatique s'inscrit dans cette perspective en références aux sémiologies des traumatismes issus de situations extrêmes comme les victimes du World Trade Center de New York (2001) ou les prises d'otages en Ossétie du nord (2004). Quatre thématiques principales conduisent à la proposition de psychose traumatique alors que la personne présente une structure psychique névrotique. (1) Il n'y a aucune inscription psychique de l'événement traumatique. La sidération confuso stuporeuse ou la fuite panique accompagnée d'hallucinations ou bouffées délirantes aiguës illustrent ce premier aspect clinique. (2) les processus psychiques ignorent le principe plaisir/déplaisir. Ils sont régis par la compulsion de répétition et les hémorragies d'affect de douleur. (3) Le paradigme de la névrose et du conflit psychique ne sont pas opératoires pour gérer les quanta d'affect et l'emprise pulsionnelle. (4) L'éclosion de délires transitoires, de conduites autovulnérantes et d'autolyse complète le tableau clinique. Le référentiel DSM-IV est insuffisant pour valider les enjeux post-traumatiques sévères. Cinq classes syndromiques étayent l'argumentation psychopathologique. (1) la sémiologie est celle d'épisodes délirants transitoires (idées et perceptions délirantes à thématiques persécutoires, cénesthésiques ou hypocondriaques), des confusions mentales (confuso oniroïdes, anxieuses ou stuporeuses), des phases de déréalisation et dépersonnalisation, des vécus agoniques, des troubles graves de l'unité corporelle, des clivages proches des dédoublements de type schizophrénique. (2) L'adhésivité traumatique souligne l'impossibilité de distanciation des victimes avec le traumatisme. Les objets sont agglutinés, persécuteurs et adhésifs. (3) La temporalité traumatique impose une omniprésence factuelle et actuelle du tra Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73527 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20553 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible Perte d'objet et menace d'effondrement dans la psychopathologie de l'adolescence / Anne-Valérie Mazoyer in L'évolution psychiatrique, Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012)
inL'évolution psychiatrique > Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012) . - 53-66 p.
Titre : Perte d'objet et menace d'effondrement dans la psychopathologie de l'adolescence Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne-Valérie Mazoyer Année de publication : 2012 Article en page(s) : 53-66 p. Note générale : Reçu le 20 Mars 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] adolescent Mots-clés : Subjectivation Dépression TAT Test projectif Cas clinique Résumé : L'adolescence correspond à la période de vie où la confrontation à la perte est vive, cruciale, particulièrement en fin d'adolescence, quand s'imposent les changements d'identité, d'idéaux, d'images de soi et de référents identificatoires, quand il faut consentir à finir l'adolescence sans s'anéantir. Nous présentons le cas de six adolescents ayant entre 17 et 19ans, rencontrés pour des motifs de consultation différents (adolescents décompensés/adolescents placés) ayant satisfait à un protocole de TAT. La fin de l'adolescence signe l'élaboration de la position dépressive, dont la problématique est réactivée lors de la présentation des planches du TAT. Suivant l'inscription signifiante des événements de vie (séparation, ruptures, décompensations...), la capacité narrative de certains adolescents sera entravée, inhibée. L'analyse des récits au TAT atteste les modalités de traitement psychique de la perte ou de tout autre événement traumatisant. En effet, les procédés d'élaboration discursive (formels et thématiques) sont les reflets de l'efficacité ou des défaillances des mécanismes de défense et de dégagement, de régulation de la résonance intime et d'aménagements des relations face à la représentation de la perte et de l'effondrement, précisément à la planche 3 BM ici mise en exergue. Cette planche nous semble favoriser la lecture des ressources psychiques sollicitées pour sublimer ou à défaut pour canaliser, contrôler l'angoisse de perte et la menace d'effondrement, fortement présentes chez certains adolescents au parcours de vie émaillé d'événements dont la charge traumatique n'a pu être encore dépassée. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73528 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20553 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible Homicide sadique sexuel, schizophrénie et « crise catathymique » : étude de cas 1 / Frédéric Declercq in L'évolution psychiatrique, Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012)
inL'évolution psychiatrique > Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012) . - 67-79 p.
Titre : Homicide sadique sexuel, schizophrénie et « crise catathymique » : étude de cas 1 Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric Declercq ; Jean-Claude Maleval Année de publication : 2012 Article en page(s) : 67-79 p. Note générale : Reçu le 20 Mars 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] comportement sexuel
[Thesaurus n°1] Troubles psychotiques:SchizophrénieMots-clés : Homicide Sadisme Psychodynamie Psychiatrie médicolégale Crise cathatymique Cas clinique Résumé : Introduits par Von Krafft-Ebing, les termes de sadisme et de meurtre sexuel renvoient à des crimes d'individus pour qui l'excitation sexuelle est intriquée à des actes violents et cruels commis sur des victimes non consentantes. Toutefois, chez le sujet schizophrène, ce type d'homicide n'a pas, semble-t-il, pour but l'obtention, mais l'annulation d'une « tension » sexuelle, vécue comme insoutenable et incoercible. Ainsi, les mutilations et l'homicide ont-ils dans ces cas une visée « libératrice » ou « soulageante ». Le concept de crise catathymique - initialement développé par Wertham et Mayer - permet de cerner et d'ordonner la dynamique qui sous-tend les crimes sadiques sexuels commis par des sujets de structure schizophrénique. Aussi ce concept ouvre-t-il de nouvelles perspectives dans l'approche clinique et pénale de ce type d'homicides. Ceci est illustré par l'étude du cas de M. X. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73529 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20553 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible L'évitement du travail dans l'affaire des s?urs Papin. Une question toujours d'actualité ? / Pascale Molinier in L'évolution psychiatrique, Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012)
inL'évolution psychiatrique > Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012) . - 81-95 p.
Titre : L'évitement du travail dans l'affaire des s?urs Papin. Une question toujours d'actualité ? Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascale Molinier Année de publication : 2012 Article en page(s) : 81-95 p. Note générale : Reçu le 20 Mars 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] 20e siècle
[Thesaurus n°1] condition de travail
[Thesaurus n°1] crime
[Thesaurus n°1] France
[Thesaurus n°1] psychologie du travail
[Thesaurus n°1] travailMots-clés : Thérapie institutionnelle Psychodynamie Représentation Relation dominant dominé Cas clinique Résumé : En 1933, deux domestiques, Christine et Léa Papin assassinèrent leurs patronnes sur le mode de la furie. Dans cet article, dont le cadre théorique est la psychodynamique du travail et la thèse de la centralité du travail dans le fonctionnement psychique, l'auteure montre que le rapport au travail et aux technologies domestiques des s?urs Papin n'a fait l'objet d'aucune considération par les psychiatres, ni au moment de leur procès, ni dans les exégèses ultérieures de Lacan et Le Guillant. Au-delà de leurs divergences, ceux-ci ont en commun de ne prendre en compte que des relations - réelles ou imaginaires -, le travail constituant l'angle mort de leurs interprétations psychogénétique et sociogénétique. Ma s?ur était énervée par le détraquement de son fer à repasser, dit pourtant Léa Papin. Un motif qui fut jugé trop futile pour qu'on s'y arrête. En tenir compte aurait signifié privilégier l'attention aux détails ordinaires et à la forme de vie des deux jeunes filles, plutôt que de se focaliser sur les aspects extraordinaires du crime. Si les concernant, il est aujourd'hui trop tard pour emprunter cette voie, du moins l'évitement du travail peut-il avoir valeur d'enseignement concernant les situations du présent. Quelle attention, quelle importance accordons-nous aux paroles sur le travail et à sa fonction dans l'aggravation ou la résolution des conflits psychiques ? Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73530 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20553 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible Violences conjugales et psychothérapie Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) : études de cas / Cyril Tarquinio in L'évolution psychiatrique, Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012)
inL'évolution psychiatrique > Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012) . - 97-108 p.
Titre : Violences conjugales et psychothérapie Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) : études de cas Type de document : texte imprimé Auteurs : Cyril Tarquinio ; Alicia Schmitt ; Pascale Tarquinio Année de publication : 2012 Article en page(s) : 97-108 p. Note générale : Reçu le 20 Mars 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] symptôme Mots-clés : Violence conjugale Thérapie cognitive EMDR Syndrome post-traumatique Dépression Anxiété Cas clinique Bilan psychologique Questionnaire Résumé : Cet article décrit les effets d'une prise en charge de femmes victimes de violences conjugales par la thérapie Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR). L'objectif était de mettre en évidence les effets curatifs de la thérapie EMDR en ce qui concerne la réduction des symptômes d'état de stress post-traumatique (ESPT), d'anxiété et de dépression. La population était constituée de cinq femmes ayant suivi entre trois et neuf sessions de 60minutes d'EMDR. Les femmes prises en charge grâce à la thérapie EMDR, voient l'ESPT et l'anxiété dont elles souffraient accuser une baisse significative et durable (maintenue à la réévaluation, six mois après la prise en charge). Les résultats obtenus vont dans le sens d'une efficacité de la thérapie EMDR auprès de ce public particulier. Ces études de cas permettent de se pencher sur la façon dont se résorbent les symptômes d'ESPT (vitesse de diminution rapide mais non homogène entre les différents symptômes). Malgré l'absence de groupe contrôle constituant une limite, ces études de cas laissent entrevoir des résultats encourageants et dégagent des pistes de réflexion en vue de nouvelles études. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73531 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20553 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible Femmes confrontées à la violence / Michel Grollier in L'évolution psychiatrique, Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012)
inL'évolution psychiatrique > Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012) . - 109-119 p.
Titre : Femmes confrontées à la violence Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel Grollier ; Isabelle Meignier Année de publication : 2012 Article en page(s) : 109-119 p. Note générale : Reçu le 20 Mars 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] crime
[Thesaurus n°1] psychanalyse
[Thesaurus n°1] violenceMots-clés : Femmes Fantasme Jouissance Lacan J Étude théorique Cas clinique Résumé : Entre femme et mère, la question du sujet féminin interroge la psychanalyse depuis ses débuts. Les « femmes battues » révèlent aux cliniciens le prix que le sujet paye parfois à la logique qu'il a déduit de la structure, point d'appui symbolique exigeant, surmoi féroce ou certitude folle. Mais l'exemple de femmes suivant leurs compagnons vers le pire, au point de se retrouver elles même épinglées comme criminelles, vient interroger autrement le rapport de ces femmes à la jouissance et leurs positions subjectives. Pour une femme, se retrouver en position d'objet pour le fantasme d'un homme c'est aussi risquer de se retrouver prise dans des positions mortifères, surtout si en place d'un fantasme elle a affaire chez ce partenaire à des constructions plus ravageantes, perverses ou délirantes par exemple. Le « devenir femme » qui interrogeait tant Freud pourrait trouver ici un certain éclairage. À partir d'un exemple et de son excès même, nous étudierons ce qui peut guetter une femme prise dans le réel de sa jouissance qui subvertit comme passion tout amour. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73532 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20553 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible To eat or not to eat : quelles sont les modalités de relations d'objet à l'œuvre dans l'anorexie mentale ? / Olivier Guilbaud in L'évolution psychiatrique, Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012)
inL'évolution psychiatrique > Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012) . - 121-144 p.
Titre : To eat or not to eat : quelles sont les modalités de relations d'objet à l'œuvre dans l'anorexie mentale ? Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier Guilbaud Année de publication : 2012 Article en page(s) : 121-144 p. Note générale : Reçu le 20 Mars 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] Troubles des comportements alimentaires:Anorexie mentale Mots-clés : Relation d'objet Métapsychologie Psychodynamie Anthropologie Étude théorique Cas clinique Résumé : Dans une approche psychodynamique et anthropologique, l'auteur aborde, à partir de vignettes cliniques, certaines modalités de relations d'objet observées dans l'anorexie mentale. Elles sont prises en compte selon trois incidences relevant du domaine de l'intrapersonnel, de l'interpersonnel et de l'intraculturel. Du point de vue intrapersonnel, la lutte contre l'avidité orale sous-tendue par la destructivité originaire à l'égard de l'objet primaire semble être au cœur de la conflictualité intrapsychique et de la fantasmatique anorexique. L'incapacité à intégrer les sentiments ambivalents à l'égard de l'objet maternant est liée à la survivance d'un surmoi précoce et sadique du fait de fixation aux stades précoces du conflit ?dipien et de l'échec relatif de l'élaboration de la position dépressive. Cette faille dans l'élaboration de cette position développementale essentielle réactivée lors de l'adolescence renforce, dans une perspective kleinienne, le recours aux mécanismes de défense obsessionnel et maniaque qui demeurent insuffisamment efficients pour apaiser les angoisses de perte objectale et les angoisses paranoïdes sous-jacentes. Du point de vue de la relation d'objet interpersonnelle, l'accent est mis sur l'organisation en faux-self caractérisée par l'importance de la soumission au narcissisme de l'objet primaire au détriment de l'épanouissement du narcissisme du sujet. Les modalités de transaction parents-enfants vont dans le sens du verrouillage des sollicitudes affectives de l'enfant. Les gratifications orales et la régression qu'elles nécessitent sont mal tolérées tandis que l'on note une valorisation du conformisme social, de la performance, de l'ascétisme et un surinvestissement de l'image du corps comme lieu de maîtrise des affects et comme pivot identificatoire central. Enfin, du point de vue intraculturel de la relation d'objet, l'anorexie mentale est considérée comme un modèle d'inconduit Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73533 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20553 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible Famille et psychiatrie sous un regard croisé : pour une anthropologie de la clinique auprès des adolescents / Franck Enjolras in L'évolution psychiatrique, Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012)
inL'évolution psychiatrique > Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012) . - 145-161 p.
Titre : Famille et psychiatrie sous un regard croisé : pour une anthropologie de la clinique auprès des adolescents Type de document : texte imprimé Auteurs : Franck Enjolras Année de publication : 2012 Article en page(s) : 145-161 p. Note générale : Reçu le 20 Mars 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] adolescent
[Thesaurus n°1] clinique
[Thesaurus n°1] désir
[Thesaurus n°1] famille
[Thesaurus n°1] psychiatrieMots-clés : Adolescent Anthropologie Cas clinique Parenté Don Résumé : Les relations entre famille et psychiatrie sont tributaires du contexte social dans lequel elles s'inscrivent. C'est notamment parce que la famille représente une des données sociales, par essence, à laquelle la psychiatrie se confronte en continu dans ses différentes activités et réflexions. Dans cet article, ces éléments seront précisés dans une approche ciblant le contexte d'émergence de ces relations et leurs implications contemporaines. Il sera question d'interroger les enjeux soutenant les rapports entre famille et psychiatrie, notamment en reprenant les définitions les concernant et leur champ d'implication. Cette mise en relief des enjeux nous permettra d'inscrire ensuite la façon dont un travail clinique, précisément auprès des adolescents, doit tenir compte de ces éléments pour s'élaborer et se penser en regard des logiques sociales contemporaines. Cette double approche, sociale et clinique, qui ne doivent pas se confondre, mais qui s'influencent malgré tout, peut donner les bases d'une anthropologie clinique, susceptible de mesurer la place de la psychiatrie dans la société et de moduler, au regard des attentes sociales actuelles, l'approche et le travail clinique. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73534 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20553 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible In memorium : Jean Ochonisky (1934-2011) / Jean Garrabé in L'évolution psychiatrique, Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012)
inL'évolution psychiatrique > Vol 77- N°1-Jan/Mars (2012) . - 164-166 p.
Titre : In memorium : Jean Ochonisky (1934-2011) Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean Garrabé Année de publication : 2012 Article en page(s) : 164-166 p. Note générale : Reçu le 20 Mars 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] humour
[Thesaurus n°1] philosophie
[Thesaurus n°1] psychanalyse
[Thesaurus n°1] sexualité
[Thesaurus n°1] subjectivitéMots-clés : Traumatisme psychique Éthique Altérité Résumé : Jacques Lacan pensait que la clinique psychanalytique devait rapprocher l'être humain de l'expérience ultime de la castration, en d'autres termes, de l'assomption tragique de l'inexistence de l'objet du désir. À partir de la pensée d'Emmanuel Levinas, l'article met en évidence la solidarité de J. Lacan et de Martin Heidegger quant au paradigme tragique qui implique l'idéalisation de l'assomption de la mort comme la dernière possibilité de l'être humain. S'inscrivant en faux contre cette conception, l'article montre d'abord combien cette assomption est plutôt une négation d'une certaine dimension de la castration humaine, celle liée à la contingence de l'autre sexuel. En effet, en distinguant l'objet petit a lacanien - neutre et imperturbable -, de l'autre sexuel - singulier et contingent -, l'article montre que l'incorporation du paradigme tragique à la clinique psychanalytique se fait au prix de l'éviction de la possibilité d'entendre et d'inscrire l'ordre traumatique et sexuel de la subjectivité. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73535 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20553 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible