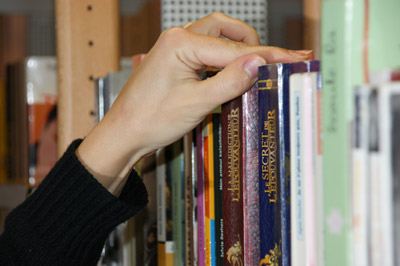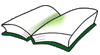Exemplaires(1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18515 | CDMA | Périodique | CDMA | Documentaire | Disponible |
Dépouillements

 Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panierGénétique de la schizophrénie : le grand retour vers la clinique ? / M.-O. Krebs in L'encéphale, Vol 36. Fas 2-Avril (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 91-93 p.
Titre : Génétique de la schizophrénie : le grand retour vers la clinique ? Type de document : texte imprimé Auteurs : M.-O. Krebs ; R. Joober Année de publication : 2010 Article en page(s) : 91-93 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65796 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 100-104 p.
Titre : Repenser le trouble panique Type de document : texte imprimé Auteurs : Othman Amami ; J. Aloulou ; M. Siala Année de publication : 2010 Article en page(s) : 100-104 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Mots-clés : agoraphobie comorbidité homogénéité trouble anxiété généralisée trouble panique Résumé : Le trouble panique (TP) est né du démembrement de la névrose d'angoisse. Depuis son introduction dans le DSM III, sa délimitation a notablement varié. Son homogénéité clinique et la fréquence de ses comorbidités suscitent toujours des questionnements. Le TP serait un trouble hétérogène et admettrait plusieurs sous-types cliniques. On lui distingue des formes paucisymptomatiques souvent méconnues et sous-diagnostiquées, des formes à expression somatique prédominante expliquant la fréquence du TP dans le contexte médical et entraînant une sous-estimation de sa prévalence et des formes selon les symptômes prédominants pouvant avoir un intérêt dans la connaissance de l'étiopathogénie du trouble et sa réponse au traitement. Les rapports du TP avec l'agoraphobie, le trouble anxiété généralisée (TAG) et les troubles de la personnalité plaident en faveur de la validité du concept de la névrose en général et de la névrose d'angoisse en particulier. Ses comorbidités fréquentes avec la dépression et les conduites suicidaires laissent évoquer une vulnérabilité commune. Toutes ces constatations doivent inciter le clinicien à un diagnostic précoce et à une prise en charge globale biopsychosociale. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65797 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Existe-t-il un lien entre catatonie et syndrome malin des neuroleptiques ? / S. Vesperini in L'encéphale, Vol 36. Fas 2-Avril (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 105-110 p.
Titre : Existe-t-il un lien entre catatonie et syndrome malin des neuroleptiques ? Type de document : texte imprimé Auteurs : S. Vesperini ; F. Papetti ; D. Pringuey Année de publication : 2010 Article en page(s) : 105-110 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Mots-clés : catatonie syndrome malin des neuroleptiques diagnostic différentiel Résumé : Les thématiques de la catatonie et du syndrome malin des neuroleptiques sont à la fois complexes et fascinantes. Beaucoup de controverses et divergences existent à leur égard. Une littérature abondante est disponible sur ces sujets, mais aucune synthèse, dont le but serait de mettre en perspective ces points de désaccord, n'a pour l'instant jamais été réalisée. Le but de cet article est donc de regrouper, clarifier et synthétiser la littérature internationale concernant la problématique du lien entre catatonie et syndrome malin des neuroleptiques. Les résultats obtenus montrent ainsi une première divergence fondamentale, puisque, pour certains auteurs, il s'agit effectivement du même trouble alors que pour d'autres absolument pas. Pourtant, au sein même du premier groupe, les avis divergent encore puisqu'on ne dénombre pas moins de cinq hypothèses différentes concernant la nature du lien. Il est, de plus, important de noter que ces arguments ne sont pas soutenus par une validité scientifique suffisante pour nous permettre de nous prononcer en faveur de l'une ou l'autre position. Il nous apparaît donc que la question du lien entre les deux entités n'est pas encore résolue. Toutes les hypothèses disponibles méritent une attention particulière et constituent l'intérêt de ces deux thèmes. Il nous semblait pourtant important de signifier l'absence de consensus disponible à ce jour concernant le lien les unissant. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65798 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Le questionnaire de personnalité dépendante (QPD) : traduction française et étude de validation dans une population de 138 patients psychiatriques hospitalisés / G. Loas in L'encéphale, Vol 36. Fas 2-Avril (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 111-115 p.
Titre : Le questionnaire de personnalité dépendante (QPD) : traduction française et étude de validation dans une population de 138 patients psychiatriques hospitalisés Type de document : texte imprimé Auteurs : G. Loas ; Jean Louis Monestès ; M. Corcos Année de publication : 2010 Article en page(s) : 111-115 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] personnalité Mots-clés : dépendance questionnaire validité échellle Résumé : L'objet de la présente étude est de présenter la traduction et la détermination de la note seuil de dépistage d'un questionnaire permettant de dépister les personnalités dépendantes selon le DSM-IV. Le questionnaire de personnalité dépendante ou QPD comprend huit items cotés de 0 à 3 avec un score total allant de 0 à 24. À partir d'un échantillon de 138 patients psychiatriques remplissant le QPD et le questionnaire de personnalité de Hyler (PDQ-4+) deux groupes ont été constitués. Utilisant le PDQ-4+ pour faire le diagnostic de personnalité dépendante, le premier groupe comprenait 25 sujets répondant aux critères de personnalité dépendante selon le DSM-IV et le second groupe de 20 sujets ne répondant à aucun des critères de la personnalité dépendante du DSM-IV. La note seuil de 13 au QPD correspondait au score de Youden (Sensibilité + Spécificité - 100) le plus élevé avec une sensibilité de 84 %, une spécificité de 90 % et une valeur prédictive positive de 91,3 %. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65799 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Validation française de la version modifiée du « Sport Anxiety Scale » (SAS) / Julie Marcel in L'encéphale, Vol 36. Fas 2-Avril (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 116-121 p.
Titre : Validation française de la version modifiée du « Sport Anxiety Scale » (SAS) Type de document : texte imprimé Auteurs : Julie Marcel ; Y. Paquet Année de publication : 2010 Article en page(s) : 116-121 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] sport Mots-clés : trait d'anxiété validation Résumé : L'anxiété dans le domaine sportif constitue un axe de recherche particulièrement étudié. Dans cette optique, de nombreux outils d'évaluation de l'anxiété ont été construits, principalement en langue anglaise puis traduits pour certains en langue française. Les derniers outils se basent sur une conception multidimensionnelle de l'anxiété avec la séparation de l'anxiété cognitive et de l'anxiété somatique. Cette distinction est admise à la fois pour l'état d'anxiété et pour le trait d'anxiété. Pour évaluer ce dernier, Smith et al. (Anxiety Res 1990;2:263-80) ont construit le « Sport anxiety scale » (SAS). Ce questionnaire (le seul outil multidimensionnel d'évaluation du trait) n'étant actuellement pas disponible en langue française, l'objectif de cette étude est de proposer une validation française d'une version modifiée (J Sports Sci Med 2006;5(3):415-23) de cet outil. Les résultats obtenus auprès de 207 sportifs permettent d'aboutir à une version en deux facteurs : anxiété cognitive (sept items ; a = 0,86) et anxiété somatique (neuf items ; a = 0,89). Les différents indices d'ajustement obtenus par analyse factorielle confirmatoire indiquent une adéquation satisfaisante avec le modèle théorique (?2/ddl = 1,60 ; Comparative fit index (CFI) = 0,98 ; Global fit index (GFI) = 0,92 ; Standardized root mean square residual (SRMR) = 0,05 ; Root mean square error of approximation (RMSEA) = 0,05). Ainsi, et dans l'attente de nouvelles études qui viendront confirmer ces résultats, cette version française présente une bonne validité sur les qualités psychométriques testées. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65800 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Évaluation des conduites addictives chez les personnes entrant en milieu pénitentiaire à partir du programme OPPIDUM du réseau des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance (CEIP) / V. Pauly in L'encéphale, Vol 36. Fas 2-Avril (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 122-131 p.
Titre : Évaluation des conduites addictives chez les personnes entrant en milieu pénitentiaire à partir du programme OPPIDUM du réseau des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance (CEIP) Type de document : texte imprimé Auteurs : V. Pauly ; E. Frauger ; F. Rouby Année de publication : 2010 Article en page(s) : 122-131 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Mots-clés : dépendance abus prison centre de soins psychotropes traitement de substitution Résumé : Les modalités de consommation de substances psychoactives consommées durant la semaine précédant l'incarcération de sujets vus en milieu carcéral ont été étudiées à partir de l'enquête observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur usage médicamenteux (OPPIDUM) entre 2003 et 2006 puis comparées à celles des sujets pharmacodépendants ou sous traitement de substitution de la dépendance aux opiacés (TSO) vus dans d'autres structures sanitaires. Sur l'ensemble des quatre années 2003 à 2006, 13 008 sujets ont été inclus dans l'étude, parmi eux 893 (7 %) des sujets ont été vus par des structures carcérales. Les sujets sont, avant leur incarcération, plus jeunes et moins bien insérés socialement que les autres sujets vus dans d'autres structures sanitaires ; ils sont plus polyconsommateurs et consomment plus souvent des substances illicites (65 % des sujets), plus de benzodiazépines (BZD), moins de TSO. Les médicaments sont consommés à des posologies plus importantes et sont plus souvent obtenus illégalement. Les caractéristiques de consommation de ces sujets avant leur incarcération ont peu évolué entre 2003 et 2006. Cette étude met en évidence la spécificité des modalités de consommation de substances psychoactives avant l'incarcération des sujets dépendants ou sous traitement de substitution par rapport aux autres sujets fréquentant une structure sanitaire et souligne la nécessité d'adapter la prise en charge sanitaire dès l'entrée en prison. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65801 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Connaissances, opinions et pratiques des professionnels concernant l'information des patients sur les infections nosocomiales : évaluation en milieu psychiatrique / E. Audureau in L'encéphale, Vol 36. Fas 2-Avril (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 132-138 p.
Titre : Connaissances, opinions et pratiques des professionnels concernant l'information des patients sur les infections nosocomiales : évaluation en milieu psychiatrique Type de document : texte imprimé Auteurs : E. Audureau ; Véronique Merle ; K. Kerleau Année de publication : 2010 Article en page(s) : 132-138 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] psychiatrie Mots-clés : infection nosocomiale information du patient évaluation des pratiques professionnelles Résumé : En France, la législation impose d'informer tout patient hospitalisé du risque d'infection nosocomiale (IN) et de sa survenue effective. En milieu psychiatrique, des difficultés dans l'application de cette réglementation peuvent être attendues du fait des pathologies rencontrées. L'objet de ce travail était d'évaluer les connaissances, l'opinion et les pratiques des professionnels de santé en psychiatrie, en matière d'information sur les IN. Un autoquestionnaire anonyme a été complété par 114 professionnels de santé exerçant dans quatre établissements ayant une activité psychiatrique en Haute-Normandie. Le niveau de connaissance des obligations réglementaires était jugé satisfaisant dans 7,0 % des cas. Seuls 5,3 % des professionnels déclaraient informer systématiquement les patients non infectés. En cas de survenue d'une IN, l'information était systématiquement donnée au patient par 13,2 % des professionnels. Alors que les professionnels étaient largement favorables à plus d'information sur les IN (86,0 %), le déficit de connaissances et de pratique constaté dans notre étude témoigne probablement à la fois de la faible fréquence et gravité des IN en psychiatrie et de difficultés spécifiques de communication avec les patients : des méthodes de communication adaptées à ces patients devraient être développées. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65802 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Implication du rapport Dintilhac dans l'expertise neuropsychologique / V. Aghababian in L'encéphale, Vol 36. Fas 2-Avril (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 139-146 p.
Titre : Implication du rapport Dintilhac dans l'expertise neuropsychologique Type de document : texte imprimé Auteurs : V. Aghababian ; C. Berland Benhaim ; C. Bartoli Année de publication : 2010 Article en page(s) : 139-146 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Mots-clés : Rapport Dintilhac expertise neuropsychologique aspects médicolégaux postes de préjudice évaluation de l'incapacité réparation du dommage coporel Résumé : Dans le cadre des expertises neuropsychologiques, il est demandé au neuropsychologue une évaluation précise des dysfonctionnements cognitifs présentés par les victimes, suite, le plus fréquemment, à un traumatisme crânien. Les missions portent le plus souvent sur : la nature des troubles neuropsychologiques, leur corrélation avec d'éventuelles lésions cérébrales, l'imputabilité avec le sinistre en cause, l'éventuelle date de consolidation et l'appréciation des postes de préjudice. Jusqu'à récemment, la réparation du dommage corporel - et, en particulier, des déficits cognitifs - se faisait essentiellement en référence à neuf postes de préjudice principaux et, en particulier, aux classiques incapacité temporaire totale (ITT) et incapacité permanente partielle (IPP). Depuis peu, le rapport Dintilhac permet d'établir une nouvelle nomenclature des chefs de préjudice corporel qui abandonne les concepts ambivalents d'IPP et d'ITT. Celle-ci adopte désormais la triple distinction entre préjudices : (1) patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; (2) temporaires et permanents et (3) des victimes directes et indirectes. Après avoir défini les nouveaux postes de préjudice des victimes directes et les avoir illustrés d'exemples issus de l'expertise neuropsychologique, nous comparons les nomenclatures classiques et nouvelles et discutons de l'implication du rapport Dintilhac dans l'évaluation de l'expert. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65803 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Approche neuroéconomique de la prise de risque à l'adolescence / G. Barbalat in L'encéphale, Vol 36. Fas 2-Avril (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 147-154 p.
Titre : Approche neuroéconomique de la prise de risque à l'adolescence Type de document : texte imprimé Auteurs : G. Barbalat ; P. Domenech ; M. Vernet Année de publication : 2010 Article en page(s) : 147-154 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] adolescent Mots-clés : prise de risque neuroéconomie système motivationnel cortex préfrontal Résumé : Les comportements à risque représentent la principale source de morbimortalité à l'adolescence. Nous proposons ici une revue des apports de l'approche neuroéconomique à la compréhension des bases physiopathologiques des comportements à risque dans cette tranche d'âge. Les outils de la neuroéconomie suggèrent en effet que les conduites à risque résultent d'un certain nombre de biais affectant le processus de prise de décision des individus - processus guidant la sélection d'un comportement adapté parmi plusieurs alternatives en fonction de leur évaluation subjective. Il a ainsi été montré que les adolescents tendent à choisir les options les plus risquées car ils ressentiraient moins d'aversion au risque et à la perte que les adultes, et parce qu'ils dévalueraient de manière particulièrement importante les conséquences futures de leurs choix. Nous présentons également dans cette revue des résultats suggérant que la fréquence élevée des comportements à risque à l'adolescence peut être reliée aux processus de maturation de deux systèmes neuronaux majeurs : les régions cérébrales du système motivationnel et celles du cortex préfrontal. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65804 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Contribution des traits psychopathiques aux comportements délinquants dans un échantillon de garçons adolescents scolarisés / C. Saint-Martin in L'encéphale, Vol 36. Fas 2-Avril (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 155-158 p.
Titre : Contribution des traits psychopathiques aux comportements délinquants dans un échantillon de garçons adolescents scolarisés Type de document : texte imprimé Auteurs : C. Saint-Martin ; H. Chabrol Année de publication : 2010 Article en page(s) : 155-158 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Mots-clés : comportements antisociaux traits psychopathiques traits limites consommation de cannabis symptômes dépressifs adolescents Résumé : L'objectif de cette étude est d'évaluer les contributions relatives des traits de personnalité psychopathiques et limites, de la dissociation, des symptômes dépressifs et des consommations d'alcool et de cannabis aux comportements délinquants des garçons adolescents. Cent cinquante-cinq adolescents et jeunes adultes scolarisés ont rempli des auto-questionnaires. Après avoir évalué à quelle fréquence ces adolescents ont commis des actes délinquants, une analyse de régression multiple dans l'échantillon total a montré que seules les consommations d'alcool et de cannabis et la dureté psychologique, trait de personnalité psychopathique, influençaient les comportements antisociaux. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65805 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Troubles du sommeil chez les aidants à domicile de patients atteints de démence / P. Thomas in L'encéphale, Vol 36. Fas 2-Avril (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 159-165 p.
Titre : Troubles du sommeil chez les aidants à domicile de patients atteints de démence Type de document : texte imprimé Auteurs : P. Thomas ; C. Hazif-Thomas ; M. Pareault Année de publication : 2010 Article en page(s) : 159-165 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] automédication
[Thesaurus n°1] Maladie d'Alzheimer
[Thesaurus n°1] sommeilMots-clés : insomnie aidants démence Résumé : Contexte : Des estimations suggèrent que plus de 700 000 adultes sont des aidants de personnes démentes et qu'un grand nombre présente, à un moment ou à un autre de leur engagement auprès du malade, diverses altérations de leur sommeil. Les professionnels de santé sont à même de repérer et gérer ces difficultés qui, compte tenu de leur ampleur, sont un enjeu de santé public. Objectif : Étude prospective du retentissement sur le sommeil de l'aidant principal de la prise en charge d'un patient dément vivant à domicile. Elle porte sur deux populations. Un groupe témoin concerne 86 personnes âgées vivant dans ou aux alentours de Limoges (France) et qui ont été contactées pour participer à l'étude par leur club du troisième âge. L'autre groupe concerne 98 aidants de personnes atteintes de démence, vivant à leur domicile et dont l'examen a été réalisé lors d'une consultation du malade. Dans chaque groupe, les personnes répondaient à un questionnaire pour décrire leurs possibles troubles du sommeil. Résultats : Les aidants sont en butte à davantage de troubles du sommeil que les personnes âgées n'ayant pas de tels soucis. Les problèmes de sommeil des aidants sont souvent liés à des difficultés similaires chez le malade. Les aidants sont plus souvent hypertendus ou dépressifs. Ils prennent davantage de médicaments et s'automédiquent plus souvent.. Discussion :Trois facteurs majeurs de troubles du sommeil de l'aidant sont ici relevés dans cet article : l'apparition chez les aidants d'éléments de vie qui rompent avec les habitudes du sommeil, le poids du fardeau qui les expose à la dépression et les risques pour la santé de l'aidant. Un traitement efficace des troubles du sommeil de l'aidant nécessite une prise en compte vigilante de ces trois facteurs. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65806 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Symptômes psychiatriques d'une encéphalite paranéoplasique à anticorps antirécepteurs NMDA : à propos d'un cas / Julie Le Foll in L'encéphale, Vol 36. Fas 2-Avril (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 166-171 p.
Titre : Symptômes psychiatriques d'une encéphalite paranéoplasique à anticorps antirécepteurs NMDA : à propos d'un cas Type de document : texte imprimé Auteurs : Julie Le Foll ; A. Pelletier Année de publication : 2010 Article en page(s) : 166-171 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] anticorps Mots-clés : encéphalite paranéoplastique récepteurs NMDA antirécepteurs NMDA excitotoxicité tératomeovaren Résumé : Nous décrivons ici le cas d'une jeune femme de 24 ans porteuse d'un tératome bénin de l'ovaire et qui a présenté un tableau d'encéphalite paranéoplasique réversible, avec la présence au premier plan d'importants symptômes psychiatriques. Dans le liquide céphalorachidien (LCR) de la patiente ont été retrouvés des anticorps dirigés contre les récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA), plus particulièrement contre un complexe de deux sous-unités du récepteur (NR1/NR2). Ces récepteurs au glutamate sont les médiateurs principaux de l'excitotoxicité et leur dysfonctionnement a été associé à différentes pathologies neurologiques (épilepsie, plusieurs types de démences) mais aussi à de nombreuses affections psychiatriques, notamment à la schizophrénie et plus récemment aux troubles de l'humeur. Ce cas renforce l'hypothèse, aujourd'hui confirmée par différentes études, de l'implication directe d'une altération de fonctionnement du récepteur NMDA dans la genèse des symptômes psychiatriques. Si l'implication du récepteur NMDA dans la symptomatologie des psychoses schizophréniques est en partie élucidée, son rôle dans les troubles de l'humeur reste flou, malgré les récentes recherches dans ce domaine. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65807 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Les troubles psychiatriques et psychocognitifs associés à la dyslexie de développement : un enjeu clinique et scientifique / M. Huc-Chabrolles in L'encéphale, Vol 36. Fas 2-Avril (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 172-179 p.
Titre : Les troubles psychiatriques et psychocognitifs associés à la dyslexie de développement : un enjeu clinique et scientifique Type de document : texte imprimé Auteurs : M. Huc-Chabrolles ; M.-A. Barthez ; G. Tripi Année de publication : 2010 Article en page(s) : 172-179 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Mots-clés : dyslexie de développement troubles des apprentissages comorbidités psychiatriques TDAH Résumé : La dyslexie est un trouble neurodéveloppemental qui touche 5 à 10 % des enfants d'âge scolaire. Ce trouble spécifique de l'apprentissage de la lecture est d'origine neurologique. Sa physiopathologie demeure inconnue mais les données scientifiques suggèrent des particularités du carrefour temporo-pariéto-occipital. Les données épidémiologiques évoquent l'implication de facteurs génétiques. Le retentissement psychique de la dyslexie se manifeste par un risque accru de troubles des conduites et de troubles anxiodépressifs chez ces enfants. Le diagnostic, la prévention et le soin de ces troubles doivent faire partie intégrante de leur prise en charge. Par ailleurs, la dyslexie survient rarement de façon isolée et les autres troubles des apprentissages (troubles d'acquisition du langage oral [30 %], la dyscalculie [25 %], les troubles du développement moteur [50 %]) et le TDAH (15 à 40 %) sont des comorbidités fréquentes. L'examen des liens de ces pathologies avec la dyslexie éclaire la recherche de sa physiopathologie d'une façon nouvelle et permet d'approfondir l'étude des facteurs étiologiques, notamment génétiques. Pour le clinicien, la connaissance de la fréquence de ces associations doit permettre une meilleure prise en charge. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65808 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Quatrièmes journées de FMC en psychiatrie, décembre 2009. Troubles dépressifs : dépistage et réponses / J.-P. Olié in L'encéphale, Vol 36. Fas 2-Avril (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Fas 2-Avril (2010) . - 180-181 p.
Titre : Quatrièmes journées de FMC en psychiatrie, décembre 2009. Troubles dépressifs : dépistage et réponses Type de document : texte imprimé Auteurs : J.-P. Olié Année de publication : 2010 Article en page(s) : 180-181 p. Note générale : Fascicule 2 - Avril 2010. Reçu le 19 Mai 2010 Langues : Français (fre) Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65809 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18515 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible