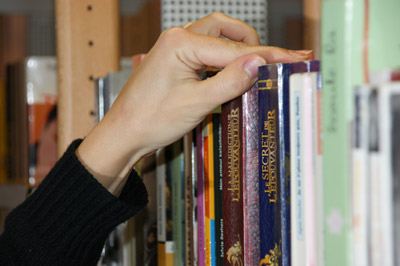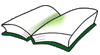Auteur A. Kaladjian
|
|
Documents disponibles écrits par cet auteur (17)


 Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesQuel est le rôle des tests et examens complémentaires dans un essai clinique en psychiatrie ? / N. Simon in L'encéphale, Vol 42 - Suppl. 6 (2016)
inL'encéphale > Vol 42 - Suppl. 6 (2016) . - p. 6S47-6S50
Titre : Quel est le rôle des tests et examens complémentaires dans un essai clinique en psychiatrie ? Type de document : texte imprimé Auteurs : N. Simon ; A. Kaladjian Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 6S47-6S50 Note générale : Reçu le 17 Janvier 2017. Supplément au n° 6 Décembre 2016. Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] psychiatrie Mots-clés : Examens complémentaires Essai clinique Résumé : De même que dans la prise en charge des patients lors des soins courants, les examens complémentaires n'ont aujourd'hui qu'une très modeste place dans les essais cliniques en psychiatrie, en l'occurence essentiellement pour compléter le bilan pré-thérapeutique avant inclusion des sujets ou surveiller la tolérance aux traitements. Or l'accumulation de données en neurosciences laisse entrevoir l'émergence de biomarqueurs, dont l'intérêt est qu'ils sont étroitement associés aux perturbations biologiques qui sous-tendent les pathologies psychiatriques, et qu'ils sont accessibles au moyen d'outils technologiques comme les équipements d'imagerie. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=91965 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24340 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible
inL'encéphale > Vol 41 - Suppl. n°6 (2015)
Titre : Symptômes négatifs et imagerie cérébrale Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Kaladjian ; M. Adida Année de publication : 2016 Note générale : Reçu le 08 Janvier 2016 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] Troubles psychotiques:Schizophrénie Mots-clés : Symptômes négatifs Neuroimagerie Résumé : De nombreuses anomalies neuroanatomiques et neurofonctionnelles ont été retrouvées par les études d'imagerie cérébrale réalisées chez les patients souffrant de schizophrénie. Néanmoins, celles associées spécifiquement aux symptômes négatifs de cette maladie sont encore insuffisamment connues. Ce travail est une revue ciblée d'études qui ont exploré les corrélats cérébraux des symptômes négatifs de la schizophrénie. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=87027 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23444 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible
inL'encéphale > Vol 39 - Suppl. 3 (2013) . - p. S162-S166
Titre : Etats mixtes et neuroimagerie Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Kaladjian ; R. Belzeaux Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. S162-S166 Note générale : Reçu le 07 Janvier 2014. Décembre 2013 Langues : Français (fre) Mots-clés : Etat mixte Bipolaire Neuroimagerie Résumé : Malgré le nombre croissant d'études de neuroimagerie dans le trouble bipolaire au cours des dernières années, les régions cérébrales impliquées dans les dérèglements de l'humeur rencontrés dans cette maladie sont encore mal connues. Si certaines anomalies neurofonctionnelles semblent indépendantes de l'état thymique, d'autres ont été associées préférentiellement aux états maniaques ou dépressifs, impliquant notamment la région amygdalienne et d'autres régions limbiques ainsi que les régions frontales ventrales, avec une vraisemblable latéralisation hémisphérique de ces anomalies selon l'état thymique examiné. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81254 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22201 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Fonctionnement neurocognitif dans la manie pure et la manie mixte / D. Pringuey in L'encéphale, Vol 39 - Suppl. 3 (2013)
inL'encéphale > Vol 39 - Suppl. 3 (2013) . - p. S157-S161
Titre : Fonctionnement neurocognitif dans la manie pure et la manie mixte Type de document : texte imprimé Auteurs : D. Pringuey ; M. Dubois ; A. Kaladjian Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. S157-S161 Note générale : Reçu le 07 Janvier 2014. Décembre 2013 Langues : Français (fre) Mots-clés : Troubles bipolaires Neurocognition Manie Etats mixtes Résumé : Les pertubations du fonctionnement neurocognitif sont actuellement considérées comme un marqueur trait des troubles bipolaires et semblent présentes dans toutes les phases de la maladie. Les études, peu nombreuses, réalisées au cours des phases thymiques (épisodes dépressifs, maniaques, hypomaniaques ou mixtes) montrent un fonctionnement neurocognitif qualitativement et/ou quantitativement différent de la normothymie et de sujets contrôles sains. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81253 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22201 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Schizophrénie et/ou trouble bipolaire : les endophénotypes neurocognitifs / A. Kaladjian in L'encéphale, Vol 38. Fas 3- Suppl (2012)
inL'encéphale > Vol 38. Fas 3- Suppl (2012) . - 81-84 p.
Titre : Schizophrénie et/ou trouble bipolaire : les endophénotypes neurocognitifs Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Kaladjian ; J.-M. Azorin ; N. Correard Année de publication : 2013 Article en page(s) : 81-84 p. Note générale : Supplément au N°3 de Décembre 2012. Reçu le 7 Janvier 2013 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] Troubles psychotiques:Schizophrénie Mots-clés : Trouble bipolaire Endophénotype Neurocognitif Résumé : Bien que la conception dichotomique des psychoses proposée par Kraepelin ait été historiquement profitable, les études modernes ne permettent pas d'étayer l'existence d'un sous-typage des troubles psychotiques en psychoses schizophréniques et troubles affectifs. Les recherches intensives menées sur la génétique de la schizophrénie et du trouble bipolaire suggèrent que ces troubles, plutôt que d'être entièrement distincts, partagent des risques génétiques communs. Cependant, l'une des difficultés importantes auxquelles se heurte la recherche génétique dans ces maladies est leur grande hétérogénéité phénotypique. Une réponse à ce problème est l'utilisation des fonctions neurocognitives en tant qu'endophénotypes ou phénotypes intermédiaires. Une revue de la littérature suggère que dans la schizophrénie comme dans le trouble bipolaire, les fonctions neurocognitives sont influencées par des facteurs génétiques et qu'il existe des déficits neuropsychologiques chez les apparentés sains des patients. Cependant, il n'est pas certain que les types de performance aux tâches neurocognitives chez les patients ainsi que leurs apparentés sains puissent représenter un moyen potentiel permettant d'identifier ou de distinguer des phénotypes neurocognitifs dans la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Les caractéristiques neurocognitives endophénotypiques spécifiques ou communes aux deux psychoses sont décrites de manière explicative. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=77253 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21403 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible
inL'encéphale > Vol 37. Suppl.2-Déce (2011) . - 110-116 p.
Titre : Prise de décision et schizophrénie Type de document : texte imprimé Auteurs : M. Adida ; M. Maurel ; A. Kaladjian Année de publication : 2012 Article en page(s) : 110-116 p. Note générale : Décembre 2011. Reçu le 2 Janvier 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] Troubles psychotiques:Schizophrénie Mots-clés : Prise de décision Iowa Gambling Task Cortex préfrontal ventromédian Revue de la littérature Résumé : Les chercheurs ont longtemps supposé que la physiopathologie de la schizophrénie était soustendue par des anomalies impliquant le cortex préfrontal (CPF). Ils ont évalué l'intégrité du CPF en se focalisant principalement sur le CPF dorsolatéral (CPFDL), et la littérature scientifique a rapporté un dysfonctionnement de cette région dans de nombreuses publications. Cependant, les anomalies présentes dans la schizophrénie s'étendraient à d'autres régions du CPF, en particulier le CPF ventromédian (CPFVM) : le dysfonctionnement du CPFVM dans la schizophrénie a été mis en évidence dans des études anatomopathologiques, d'imagerie structurale et d'imagerie fonctionnelle. Les patients cérébrolésés au niveau du CPFVM ont développé des troubles du comportement d'un point de vue social et des troubles du jugement dans leur vie personnelle. L'Iowa Gambling Task (IGT) ou test du jeu de poker a été créé pour évaluer les capacités de prise de décision de ces patients neurologiquement atteints : ce test présente au sujet une série de 100 pioches de cartes parmi quatre piles de cartes qui diffèrent dans leur distribution des gains et des pertes. Tandis que les sujets volontaires sains piochent préférentiellement dans les deux piles de cartes « avantageuses », les patients cérébrolésés persistent à piocher des cartes dans les deux piles « désavantageuses », piles associées à court terme à des renforcements positifs, mais entraînant à long terme une importante dette d'argent. Il est intéressant de noter que des lésions au niveau du CPFVM ont pour conséquence un déficit d'insight, c'est-à-dire une non-conscience des modifications comportementales présentées par ces patients, associée à un déficit de performance à l'IGT. Récemment, notre groupe de recherche a rapporté des anomalies des capacités de prise de décision dans les trois phases du trouble bipolaire. De plus, dans une étude d'imagerie fonctionnelle par tomographie Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=72395 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20381 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible Schizophrénie, cognition et neuro-imagerie / A. Kaladjian in L'encéphale, Vol 37. Suppl.2-Déce (2011)
inL'encéphale > Vol 37. Suppl.2-Déce (2011) . - 123-126 p.
Titre : Schizophrénie, cognition et neuro-imagerie Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Kaladjian ; E. Fakra ; M. Adida Année de publication : 2012 Article en page(s) : 123-126 p. Note générale : Décembre 2011. Reçu le 2 Janvier 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] Troubles psychotiques:Schizophrénie Mots-clés : Cognition Neuro-imagerie Résumé : La schizophrénie est une maladie complexe dont les mécanismes sont encore largement inconnus. L'imagerie cérébrale fonctionnelle, en faisant le lien entre psyché et cerveau, est récemment devenue un outil indispensable pour étudier in vivo les bases neurales qui sous-tendent les dysfonctionnements cognitifs observés dans cette maladie. Mais malgré la multiplication des données issues de cette approche, l'impact exact de l'imagerie fonctionnelle sur notre compréhension de la maladie reste flou. De façon générale, les études du fonctionnement cérébral des patients schizophrènes retrouvent des anomalies d'activation qui varient de nature et de localisation selon le paradigme cognitif utilisé. Il apparaît néanmoins de façon générale que les anomalies neurofonctionnelles observées chez les patients ne peuvent se réduire à un simple déficit bien localisé. Ce serait plutôt une altération de la dynamique des interactions entre différentes régions cérébrales qui sous-tendrait les perturbations cognitives rencontrées dans la maladie. L'imagerie cérébrale fonctionnelle offre actuellement de nouvelles perspectives pour préciser les caractéristiques dynamiques des réseaux cérébraux, et plus particulièrement ceux impliquées dans les fonctions cognitives de haut niveau comme le contrôle cognitif ou la cognition sociale qui semblent jouer un rôle crucial dans la maladie. La mise en évidence de telles caractéristiques représente un enjeu important non seulement pour développer de nouvelles hypothèses physiopathologiques, mais aussi de façon plus pragmatique pour identifier de potentielles cibles thérapeutiques. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=72397 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20381 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible
inL'encéphale > Vol 37. Suppl.2-Déce (2011) . - 137-142 p.
Titre : Schizophrénie, psychotropes et cognition Type de document : texte imprimé Auteurs : E. Fakra ; A. Kaladjian ; M. Adida Année de publication : 2012 Article en page(s) : 137-142 p. Note générale : Décembre 2011. Reçu le 2 Janvier 2012 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] Troubles psychotiques:Schizophrénie Mots-clés : Cognition Antipsychotiques Cothérapie Résumé : L'association robuste et spécifique entre certaines fonctions cognitives et le pronostic fonctionnel de la schizophrénie a suscité un intérêt considérable pour le déficit cognitif caractéristique des patients souffrant de schizophrénie. Dans les stratégies envisagées pour corriger ce déficit, les solutions pharmacologiques tiennent une place prépondérante. En premier lieu, cet article se propose de faire le bilan et de rendre compte des considérations actuelles quant à l'efficacité des traitements antipsychotiques sur les troubles cognitifs de la schizophrénie. La distinction entre antipsychotiques classiques et antipsychotiques atypiques est reprise afin d'examiner plus précisément les études comparant les effets de ces deux types de molécule sur la cognition. En particulier, une grille de lecture permettant une analyse critique mais basique des biais méthodologiques est proposée afin de reconsidérer les résultats apportés par ces études. Il apparaît alors que les différences entres antipsychotiques atypiques et classiques ne sont pas aussi contrastées que ce qui pouvait être initialement attesté. Aussi, les antipsychotiques atypiques s'avèrent-ils former une classe pharmacologique hétéroclite et il y aurait intérêt à différencier l'effet de chaque antipsychotique plutôt que de les considérer dans leur ensemble. Une dernière partie est consacrée aux stratégies d'adjonction de traitements, en exposant les résultats assez modestes obtenus à l'aide de telles stratégies. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=72400 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20381 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible Symptôme en psychiatrie et neuro-imagerie / A. Kaladjian in La lettre du psychiatre, Vol VII-N°2 Mars-Avr (2011)
inLa lettre du psychiatre > Vol VII-N°2 Mars-Avr (2011) . - 62-64 p.
Titre : Symptôme en psychiatrie et neuro-imagerie Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Kaladjian Année de publication : 2011 Article en page(s) : 62-64 p. Note générale : Mars/Avril 2011. Reçu le 3 Mai 2011 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] psychiatrie
[Thesaurus n°1] symptômeMots-clés : neuro-imagerie IRMf Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69158 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19360 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible Interaction gènes-environnement dans les troubles affectifs / J.-M. Azorin in L'encéphale, Vol 36. Sup. 6-Déc (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Sup. 6-Déc (2010) . - p.167-172
Titre : Interaction gènes-environnement dans les troubles affectifs Type de document : texte imprimé Auteurs : J.-M. Azorin, Auteur ; A. Kaladjian ; E. Fakra Année de publication : 2011 Article en page(s) : p.167-172 Langues : Français (fre) Catégories : [Thesaurus n°1] environnement Mots-clés : Gène Interaction Dépression Troubles affectifs Trouble bipolaire Résumé : Le kindling et la sensibilisation comportementale furent probablement les premiers parmi les modèles animaux des troubles affectifs à suggérer que des interactions gènes-environnement puissent intervenir dans la physiopathologie de ces affections. La sensibilisation croisée entre le stress, les toxiques et les épisodes thymiques était censée être sous-tendue par l'induction d'une série de facteurs transcriptionnels, tels que le proto-oncogène c-fos, susceptible d'altérer secondairement l'expression génique par liaison aux sites ADN et induction d'ARN messagers pour des molécules exerçant des effets à long terme. Cette hypothèse anticipait de fait le domaine de l'épigénétique actuellement défini comme celui des modifications fonctionnelles de l'ADN ne s'accompagnant pas d'altérations de sa séquence. Les modifications épigénétiques sont le plus souvent régulées par la méthylation de l'ADN et l'acétylation des histones qui sont habituellement respectivement associées à la répression et l'activation de la transcription génique. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=68082 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19071 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible Troubles affectifs : évolution des modèles nosographiques / A. Kaladjian in L'encéphale, Vol 36. Sup. 6-Déc (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Sup. 6-Déc (2010) . - p.178-182
Titre : Troubles affectifs : évolution des modèles nosographiques Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Kaladjian, Auteur ; J.-M. Azorin ; M. Adida Année de publication : 2011 Article en page(s) : p.178-182 Langues : Français (fre) Mots-clés : Trouble affectif Trouble bipolaire Dépression Nosographie Résumé : Dans l'histoire des nosographies en psychiatrie, les troubles affectifs se sont progressivement distingués des autres catégories de maladies mentales, jusqu'à former des entités propres, comme celle que Kraepelin nomme folie maniaco-dépressive à la fin du xixe siècle. Cette dernière sera ensuite découpée en deux grandes catégories, le trouble bipolaire d'une part et les dépressions récurrentes d'autre part, découpage encore actuel et qui s'est imposé par le biais du manuel diagnostique et statistiques des troubles mentaux (DSM). Ce manuel, dont les révisions déterminent largement l'évolution des modèles nosographiques contemporains, repose principalement sur une approche catégorielle des troubles mentaux. La prochaine révision pérennisera probablement ce type d'approche, même si l'utilisation de composantes dimensionnelles pourrait être également développée. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=68084 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19071 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible
inL'encéphale > Vol 36. Suppl. 1 (2010) . - 8-12 p.
Titre : Phase prodromale du trouble bipolaire Type de document : texte imprimé Auteurs : E. Fakra ; A. Kaladjian ; D. Da Fonseca Année de publication : 2010 Article en page(s) : 8-12 p. Note générale : Supplément 1 Janvier 2010. Reçu le 11 Mars 2010 Langues : Français (fre) Mots-clés : prévention secondaire intervention précoce trouble bipolaire ADHD Résumé : La phase prodromale, décrite généralement comme une étape subsyndromique précédent l'entrée dans la maladie, présente un intérêt essentiellement dans la prévention secondaire. Jusqu'à présent, les recherches cliniques en santé mentale portant sur ce thème se sont essentiellement tournées vers la schizophrénie. Sur les dernières années, certains travaux ont appliqué des méthodes similaires afin de caractériser une phase préclinique dans les troubles bipolaires. Malgré le fait que cette stratégie semble moins adéquate dans les troubles bipolaires, ces études ont toutefois pu démontrer l'existence de signes prodromiques chez une majorité de patients. Cependant, les symptômes formant cette phase prodromale n'apparaissent pour le moment ni suffisamment caractéristiques, ni suffisamment spécifiques pour pouvoir donner lieu à des instruments de dépistage adéquats, ou pour susciter des recommandations précises de prise en charge. La tactique consiste alors à se baser à la fois sur la notion de haut risque génétique et de s'appuyer sur des symptomatologies limitrophes des critères des classifications actuelles pour cerner les sujets candidats à une intervention précoce. Pourtant, même dans ce cadre, un traitement pharmacologique ne semble pas montrer un avantage évident en termes de prévention. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64292 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17620 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Polarité maniaque du premier épisode d'un trouble bipolaire : aspects cliniques et pronostiques / A. Kaladjian in L'encéphale, Vol 36. Suppl. 1 (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Suppl. 1 (2010) . - 13-17 p.
Titre : Polarité maniaque du premier épisode d'un trouble bipolaire : aspects cliniques et pronostiques Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Kaladjian ; E. Fakra ; M. Adida Année de publication : 2010 Article en page(s) : 13-17 p. Note générale : Supplément 1 Janvier 2010. Reçu le 11 Mars 2010 Langues : Français (fre) Mots-clés : trouble bipolaire manie premier épisode polarité maniaque Résumé : Les études décrivant le cours évolutif du trouble bipolaire depuis le premier épisode ont apporté des informations importantes relatives au pronostic de la maladie chez les patients qui présentent un épisode maniaque inaugural. Deux approches différentes ont été utilisées dans ces études. Les études prospectives, conduites sur les quelques années suivant le premier épisode, ont souligné la mauvaise évolution symptomatique et fonctionnelle à court terme de ces patients. Les études rétrospectives, plus adaptées pour apprécier l'évolution à long terme selon les caractéristiques présentes en début de maladie, ont mis en évidence de façon consistante que la polarité de l'épisode initial est prédictive de la polarité dominante du trouble pour un patient donné. Compte tenu des conséquences péjoratives des récurrences sur le cours évolutif de la maladie et le fonctionnement psychosocial des patients, un diagnostic précoce à l'issue du premier épisode maniaque est une étape critique pour la prescription d'un traitement normothymique dès le début de la maladie. Une connaissance précise des caractéristiques cliniques et évolutives des patients dont le premier épisode bipolaire est maniaque peut aider les cliniciens à développer des interventions thérapeutiques plus spécifiques et mieux adaptées à ces patients. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64293 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17620 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Premier épisode dépressif d'un trouble bipolaire : aspects cliniques et pronostiques / N. Besnier in L'encéphale, Vol 36. Suppl. 1 (2010)
inL'encéphale > Vol 36. Suppl. 1 (2010) . - 18-22 p.
Titre : Premier épisode dépressif d'un trouble bipolaire : aspects cliniques et pronostiques Type de document : texte imprimé Auteurs : N. Besnier ; E. Fakra ; A. Kaladjian Année de publication : 2010 Article en page(s) : 18-22 p. Note générale : Supplément 1 Janvier 2010. Reçu le 11 Mars 2010 Langues : Français (fre) Mots-clés : trouble bipolaire dépression premier épisode polarité Résumé : Dans la majorité des cas, les patients souffrant de trouble bipolaire ont présenté un ou plusieurs épisodes dépressifs avant que soit posé le diagnostic. La polarité dépressive du premier épisode thymique est corrélée avec un début précoce de la maladie, une évolution chronique, une polarité dominante dépressive, un risque suicidaire élevé et une grande fréquence des formes à cycles rapides.Parmi les patients présentant un premier épisode dépressif, ceux ayant un risque de développer ultérieurement un trouble bipolaire pourraient être identifiés par certaines caractéristiques anamnestiques, cliniques et évolutives. Si l'identification de ces facteurs de risque n'exerce à ce jour pas d'impact direct sur les recommandations en termes de prescription médicamenteuse, elle incite en revanche à une étroite surveillance clinique et à la mise en place de mesures psychoéducatives. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64294 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17620 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible
inL'encéphale > Vol 36. Suppl. 1 (2010) . - 23-26 p.
Titre : Traitement d'un premier épisode maniaque Type de document : texte imprimé Auteurs : M. Maurel ; A. Kaladjian ; E. Fakra Année de publication : 2010 Article en page(s) : 23-26 p. Note générale : Supplément 1 Janvier 2010. Reçu le 11 Mars 2010 Langues : Français (fre) Mots-clés : premier épisode maniaque diagnostic différentiel alliance thérapeutique prévention des récurrences Résumé : Le premier épisode maniaque, lorsqu'il n'est pas directement lié à une pathologie somatique ou toxique, signe le trouble bipolaire. Ces possibilités doivent être systématiquement éliminées par un bilan biologique et morphologique. Son identification clinique est difficile principalement en raison d'une présentation clinique le plus souvent atypique. S'il peut survenir à tout âge, il touche préférentiellement une population de sujets jeunes où l'usage de toxiques est courant. Les formes psychotiques sont particulièrement fréquentes de même que certains symptômes comme l'irritabilité. Le traitement de la phase aiguë n'est pas distinct des autres épisodes maniaques, mais les enjeux sont très différents puisque, si après un premier épisode il existe déjà souvent une dégradation fonctionnelle, elle s'accentue considérablement avec la répétition des accès. Il est donc essentiel d'établir le plus tôt possible une alliance thérapeutique de qualité qui facilitera la mise en place, l'acceptation et l'observance du traitement préventif ainsi que l'adhésion à différentes recommandations d'hygiène de vie. Des études cliniques sont nécessaires afin de mieux préciser quel traitement préventif est le plus adapté à cette population. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64295 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17620 CDMA Périodique CDMA Documentaire Disponible Les anomalies structurales observées en imagerie cérébrale dans le trouble bipolaire / A. Kaladjian in L'encéphale, volume 32/juil.août (2006)
inL'encéphale > volume 32/juil.août (2006) . - 421-436 p.
Titre : Les anomalies structurales observées en imagerie cérébrale dans le trouble bipolaire Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Kaladjian ; P. Mazzola-Pomietto Année de publication : 2007 Article en page(s) : 421-436 p. Langues : Français (fre) Mots-clés : anomalies structurales IRM neuroimagerie trouble bipolaire Résumé : Les études de neuroimagerie structurale montrent, dans le trouble bipolaire, la présence d'un certain nombre d'anomalies cérébrales.Les anomalies les plus souvent retrouvées sont des hyperintensités de la substance blanche dans les régions périventriculaires et sous-corticales profondes, un élargissement modéré des ventricules cérébraux touchant surtout le ventricule latéral droit, des altérations de la substance grise et de la substance blanche dans les régions frontale, cingulaire et temporale, ainsi que des changements de volume des structures sous-corticales, comprenant en particulier l'amygdale, le thalamus et les ganglions de la base. Il existe une grande hétérogénéité des changements morphométriques observés dans ces travaux, qui peut s'expliquer en particulier par la variabilité des méthodes utilisées et des caractéristiques cliniques des patients étudiés. Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=53913 [article]
inL'encéphale > Vol 31-fas 3 (2005) . - 359-365 p.
Titre : Aspects actuels du trouble schizo-affectif Type de document : texte imprimé Auteurs : J.-M. Azorin ; A. Kaladjian ; E. Fakra Année de publication : 2007 Article en page(s) : 359-365 p. Langues : Français (fre) Mots-clés : schizo-affectif schizo-dépression schizo-manie Résumé : Le trouble schizo-affectif est une affection fréquente puisqu'il représenterait entre 10 et 30% des administrations pour trouble psychotique en milieu psychiatrique. Depuis sa description initiale par Kasanin en 1993, le concept de trouble schizo-affectif a connu de nombreux changements dans sa définition. Les critères diagnostiques actuels du DSM-IV et de l'ICD-10 diffèrent notamment par l'accent respectif mis sur la nature des symptômes, en particulier celle des symptômes psychotiques, et le chevauchement dans le temps de ces symptômes et des troubles de l'humeur. Différentes formes cliniques du trouble ont été proposées, en particulier une forme bipolaire et une forme dépressive. Parmi les nombreux modèles explicatifs, les auteurs actuels privilégient, sur la base des données empiriques disponibles, l'hyothèse d'une appartenance à un spectre psychotique unitaire dont la vulnérabilité pourrait être activée à l'occasion d'un épisode thymique. Sur le plan pharmacologique, malgré l'absence de recommandations thérapeutiques existantes, les antipsychotiques de seconde génération, utilisés en monothérapie ou en association, semblent constituer la base du traitement, à court terme comme à long terme. Note de contenu : Div. Doc : Mai/Juin 2005. Reçu le 12 Juillet 2005. Pages 265-390 / Permalink : https://ch-poitiers.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38931 [article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 11726 ARCHIVES Périodique CDMA Documentaire Disponible